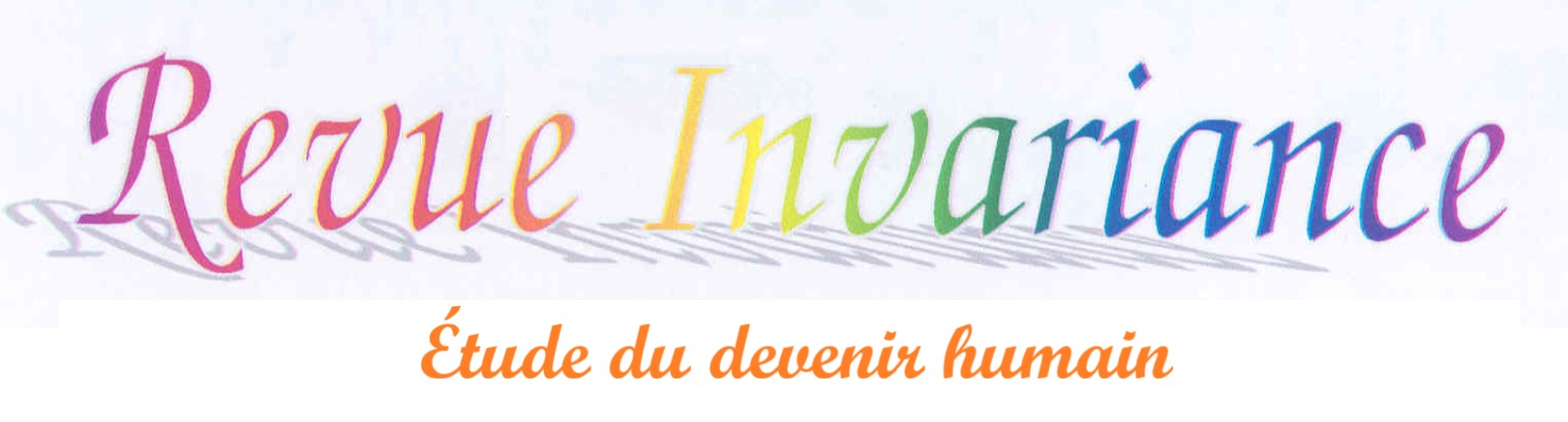
SURGISSEMENT
ET DEVENIR DE L’ONTOSE
II. Devenir
de l’ontose
1 La multiplicité des formes du devenir de l’ontose ne va pas être envisagée (elle ne peut l’être que dans des études particulières), mais on va mettre en évidence les phénomènes essentiels qui caractérisent ce devenir et permettent sa réalisation.
2 De façon encore plus déterminante que
pour son surgissement, le développement et la maturation de l’ontose s’opèrent
en interaction avec la spéciose, telle qu’elle se présente dans une aire géo-sociale donnée. En effet, plus la communauté devient
évanescente, moins ce qui tend à devenir individu se trouve à même d’être
récupéré, réintégré, donc remis en continuité. Il doit de plus en plus opérer
par lui-même (autonomisation) et, ce faisant, se déploie dans l’ontose.
Développement de l’individu et
développement de l’ontose vont de pair. Parler d’individu ontosé
revient à déclamer une superfetation. Elle s’avère
nécessaire pour être compris.
Nous envisageons la réalisation de l’individu ontosé dans l’aire occidentale à un moment d’évanouissement de la société, devenue société-communauté du capital, qui est entrée en dissolution, et à un moment où l’individu s’évanouit lui aussi. Toutefois il faut tenir compte des phénomènes anciens qui permettent de comprendre l’ontose sous sa forme actuelle et, en outre, il est nécessaire parfois de prendre appui sur des données relevant d’autres aires pour montrer la généralité du phénomène ontose [1] .
3 Dans le devenir de la spéciose ayant un profond retentissement sur l’ontose, se place le détournement de la technique. On peut le situer, pour le moment, à l’aube du néolithique, lors de la sédentarisation et de la genèse de l’agriculture. Ce détournement consiste en ce que la technique n’est plus simplement utilisée, effectuée, en tant que mise en continuité avec l’environnement, permettant à l’homme, à la femme de se prolonger en lui et par là de pouvoir s’affirmer et se positionner, ce qui est une effectuation de l’haptoévolution [2] , mais comme une médiation de la relation au sein de la communauté subissant une fragmentation.
4 Le détournement de la technique ne fut possible que parce qu’à un moment donné du devenir de Homo sapiens elle en vint à être séparée du langage verbal. La séparation du geste et de la parole permit leur autonomisation. La thérapie, elle-même une technique, en présuppose une autre, en quelque sorte plus insidieuse, celle de l’amour devenant opérateur d’apaisement, et du pouvoir se muant en dynamique de l’affirmation de la contrainte.
5 La technique vise à opérer en tant qu’articulation pour maintenir
uni ce qui se fragmente. Autrement dit il y a une intériorisation de la
technique, venant suppléer la perte d’innéité qui permettait, au sein de la
communauté, la réalisation immédiate des diverses relations entre tous ses
membres.
Sans l’intériorisation de la technique, la ville, la polis, n’auraient pas pu se développer.
6 Lors de la naissance de la polis, en Occident, le
phénomène est réactivé, amplifié. Il fut théorisé, sans qu’il y en eut perception consciente, que ce soit par les présocratiques,
par les tragiques, puis par Platon et Aristote, pour signaler les théoriciens
les plus importants.
Un phénomène semblable s’effectua en Inde où, par exemple,
la théorisation de la «voie moyenne» fut un exposé technique visant à indiquer
comment éviter les deux extrêmes sur lesquels s’épanouit la folie: l’excès et
la dépression [3] .
En Chine, à l’époque des Royaumes combattants (475-221 a.C.), on a un foisonnement de théories comparables à celles qui apparurent en Grèce, mais allant parfois encore plus loin dans l’utilisation de la technique intériorisée. L’«Introduction» remarquable de J. Lévi au livre – très intéressant du point de vue que nous exposons – de Han-Fei-tse, Le Tao du prince [4] , fait revivre les débats de cette période. La conclusion qui émerge après lecture – confortée par celle d’autres ouvrages – est que sans l’intériorisation de la technique aucune manipulation n’eut été possible, donc aucune éducation, particulièrement celle fondée directement sur le principe c’est pour ton bien, et donc aucune pédagogie.
7 Dans les trois aires géo-sociales [5] précédemment citées, le devenir hors nature induisant divers maux qu’il faut éliminer ou, tout au moins, corriger, la technique par excellence qui va s’imposer afin que le procès de vie, tant au niveau social qu’individuel puisse s’effectuer, est la thérapie.
8 A partir du
moment où s’opère l’intériorisation de la technique, un bouleversement important
se met en place, celle-ci tend à devenir ce qui va consentir à l’espèce de se
séparer de plus en plus de la nature, en même temps qu’elle vise à permettre l’autodomestication qui se réalise à travers le dressage des
diverses générations qui devront s’adapter à un environnement de moins en moins
naturel. Pour ce faire un développement énorme de la technique devient de plus
en plus nécessaire. Au cours des siècles la technique devint une médiation
toujours plus déterminante et, comme toute médiation, elle tendit à
s’autonomiser et à devenir despotique comme cela apparaît aujourd’hui où
l’homme, la femme vivent au sein de la technique. Ceci ne put s’effectuer qu’à
la suite du développement de la valeur d’abord, du capital ensuite. Ce sont eux
les éléments déterminants et non la technique. Ce qui implique de chercher à
saisir qu’est-ce que l’espèce a tendu à résoudre en les produisant [6] .
Le rapport de l’espèce à la technique a donc connu un phénomène de renversement: de pratique assurant la continuité avec le reste de la nature elle devient ce qui l’en éloigne de plus en plus [7] .
9 L’édification de l’être ontosé s’effectue à partir de ce qu’on peut nommer seconde naissance, moment où la coupure de continuité est subie et où l’enfant réalise la plénitude de sa dépendance et où il lui semble que ce soit sa mère qui lui donne la vie. C’est comme une naissance culturelle imposée et vécue inconsciemment, qui deviendra toujours plus déterminante parce que c’est à partir d’elle que toutes les empreintes vont opérer pour contribuer à la constitution de l’être ontosé.
10 Le devenir de l’être s’ontosant se constitue par la succession de réinstaurations, de remontées, parce que, constamment, de façon inconsciente, il revit toute la phase de vie qui va de la conception à l’affirmation du moment de coupure de la continuité. Et ceci va s’articuler avec l’action des parents et des diverses personnes avec qui l’individu va manifester ses schémas comportementaux, ainsi qu’avec l’action de la société en tant que telle.
11 Ce devenir
comporte trois moments de coupure.
Celui initial par
suite de la non acceptation de l’enfant dans sa naturalité, qui fonde la
dynamique du devenir sujet-objet.
Vient ensuite le moment
de la coupure au sein de l’individu même, se traduisant par un déchirement et
un dédoublement. C’est la séparation d’avec l’être originel. L’essence du
nouvel être est la séparation. Tout être ontosé a en
lui une dimension schizoïde [8] .
Le troisième moment est celui de la coupure d’avec la nature, c’est-à-dire de la séparation par rapport à d’où l’on vient, d’où l’on émerge [9] , d’avec le fondement de notre individualité-Gemeinwesen. Cette coupure est induite par la nécessité de s’arracher à la nature pour enrayer le phénomène de rétention. En effet, on s’emplit du flux de vie naturelle qui ne peut plus s’épanouir, s’irradier du fait de la séparation et qui, par là, nous emplit, nous engorge; rétention opérant en dépit de notre désir qu’il y ait fluidification, qu’il y ait écoulement avec nos semblables [10] .
12 La coupure initiale fonde la mère en tant que support de
dieu. Celle au sein de l’individu fonde la quête de l’unité perdue qui se
confond avec celle de l’union avec la mère, d’où la réactivation de la
confusion. La coupure d’avec le reste de la nature fonde le culte de l’espèce,
l’humanisme, et le devenir au solipsisme exprimant un repli sur soi et une
perte de certitude.
13 En dehors de la première, le caractère de ces coupures est de ne pas être défini, totalement réalisé. En outre, en ce qui concerne la première, elle n’est jamais consciemment vécue en tant que telle, d’où l’emprise de la confusion. La pleine réalisation de la deuxième implique une schizophrénie totale et donc la folie. La troisième opère de façon tendancielle, au niveau de l’espèce comme de l’individu. C’est au sein de ce dernier qu’elle peut le plus facilement se réaliser.
14 Dans les anciennes communautés ainsi que dans les sociétés où le phénomène de la valeur, puis celui du capital, n’est pas déterminant s’imposait une troisième naissance qui, elle, était vécue consciemment, sous la contrainte: l’initiation. C’était une naissance à la communauté se séparant de la nature, à la société. Au cours de cette initiation, l’enfant subissait un traumatisme important, rejouement des deux autres, imposé volontairement par les adultes afin de le séparer de la mère, de l’innéité, de la nature, et de l’intégrer dans le monde communautaire se posant sur le mode de la séparation, dans le monde social.
15 Le sevrage défini comme moment de cessation de l’allaitement n’est pas naturellement porteur de traumatisme. Cependant il le devient quand il est imposé par la mère. Le traumatisme se présente alors comme rejouement de celui de la naissance. Quand il n’y a pas allaitement, mais nourrissage au biberon, le sevrage est pour ainsi dire escamoté et l’enfant entre beaucoup plus tôt dans une dynamique dominée par l’artificialité, par la substitution. Escamotage, artificialité, substitution entrent dans la dynamique de la domestication, de la séparation d’avec la nature, de la naturalité.
16 L’initiation était le procès qui permettait d’effectuer la sortie de la nature. Elle se posait comme rupture de la dépendance vis-à-vis d’elle, ce qui initiait le procès d’acculturation, d’artificialisation [11] , qui est en germe celui de la virtualisation.
De nos jours où la coupure a été réalisée ou est en voie de l’être, cette pratique s’évanouit. Il en reste des traces marquées par la violence. Il n’y a plus réellement besoin d’initier quelque chose qui est depuis longtemps établi et transmis d’une génération à l’autre.
17 L’initiation impliquait une mort, celle de l’être ayant évolué antérieurement en union avec la mère, avec la nature. C’était donc aussi une renaissance, une résurrection au sein d’un autre monde. D’où la nécessité d’acquérir une connaissance nouvelle apte à permettre à l’individu de se comporter dans un monde nouveau.
18 Le développement
de l’ontose s’effectue à partir d’un moment où s’impose le numen
en lequel est inclus le nomen, moment vécu comme un
présent hypertrophié, racine de la toute puissance envahissante du passé sur le
devenir de l’être ontosé, et de la dimension mystique
présente de façon plus ou moins explicite en chaque homme, en chaque femme
ainsi que de la tendance à vivre la dépendance, même si elle est compensée par
un fort désir d’autonomie, ou de surpuissance. Plus précisément, la coupure de
continuité, provoquée par la non acceptation de la naturalité de l’enfant par
la mère, provoque l’instauration de l’état hypnoïde comportant une dimension
mystique. Chez certains hommes, certaines femmes, celle-ci est tellement
puissante qu’elle s’impose comme un état.
Le nomen est en rapport avec l’interrogation: la mère va-t-elle dire, raconter ce qui est advenu. De là, l’émergence des mythes. Le mythe est ce qui fonde l’origine qui consiste en la séparation, en un moment de discontinuité.
19 Le nomen s’impose au sein de la dynamique de distinction, de
séparation, entre la mère et l’enfant, en même temps que ce à quoi celui-ci
doit atteindre pour être en continuité avec ce qui l’interpelle. Il s’impose
d’autant plus que la capacité télépathique a quasiment disparu. En conséquence,
et par suite de divers rejouements au cours de
millénaires, le langage verbal apparaît à certains comme étant un médiateur de
séparation qu’il faut rejeter [12]
20 La pensée et le langage verbal s’affirment originellement à travers un traumatisme, générateur de confusion, dont l’espèce n’est pas encore sortie; comme l’atteste le grand développement des mondes virtuels, de la virtualité, surtout en ce qui concerne la pensée.
21 Le présent dilaté originel fonde l’illo tempore, un temps de rêve, un temps comme immobilisé qui est celui de la contemplation qui peut aboutir à l’extase (sortie de soi), à une identification, à une fusion avec une entité.
22 Le moment du numen opère comme un point fixe à partir duquel l’être ontosé développe ce que les psychologues appellent «fiction», «scénario», «style de vie»; on peut dire l’ensemble des interprétations que le tout jeune enfant élabore pour se positionner au sein d’une situation où il est nié dans sa naturalité, et justifier le comportement de ses parents. Ces interprétations peuvent effectivement apparaître fausses, fantasmatiques, au regard de l’adulte; elles n’en ont pas moins été nécessaires à l’enfant pour survivre et sousvivre. Ce qui cause de graves troubles dans le comportement de l’adulte c’est le maintien d’une solution qui fut valable à une époque où il fut placé dans l’impuissance, la dépendance et l’immense solitude, alors qu’il ne se trouve plus dans une telle situation.
23 Selon les individus le point fixe s’ancre en quelque sorte soit dans la mère posée numen ce qui favorisera une dimension mystique, ou une appréhension des événements à partir de l’objet, soit dans l’enfant favorisant alors une appréhension plus subjective, enfin soit dans le vide, placé entre l’enfant et la mère, favorisant une approche nihiliste [13] .
24 L’irrationnel dérive d’un cheminement hors nature qui met l’espèce perpétuellement en contradiction avec ses présupposés. Sont de l’ordre de l’irrationnel: la répression parentale (en connexion à la répression sociale), le numen, l’ontose. Ils fondent à leur tour la dimension irrationnelle dans le comportement, dans le vécu de l’homme, de la femme. Tout en étant en connexion génétique, les éléments constituants de l’irrationnel ne se manifestant pas en continuité semblent surgir de réalités différentes.
25 Tout homme, toute femme, cherche inconsciemment à lever l’irrationnel qui s’impose, se fonde au moment du vécu en face de ce qui s’instaure numen. On ne trouve pas d’irrationnel dans la nature, sinon des supports pour le revivre. Lever l’irrationnel fonde la tentative de rationalisation opérée successivement par la religion, la philosophie, la science. C’est un travail jamais fini et qui se réimpose constamment du fait de l’impossibilité de lever la confusion initiale où chacun, chacune, s’est trouvé(e). Il est impossible, pour l’être ontosé d’éliminer la dimension irrationnelle, mystique [14] .
26 L’existence de cet irrationnel exacerbe la recherche d’un sens, qui devient un tourment; d’un sens en tant que signification, en tant que direction que l’écoulement d’un devenir peut emprunter [15] . Le moment de l’irrationnel nous fixe à l’origine, nous attache au passé; c’est celui de l’hypnotisation.
27 L’hyperdéveloppement du droit dérive non seulement de nécessités intrinsèques de la société-communauté en place, tendant à sa dissolution, mais également du désir inconscient, tant au niveau de l’espèce que de l’individu, d’éliminer la confusion liée à l’irrationnel.
28 Parallèlement
s’impose la préoccupation au sujet de l’invisible qui, en fait, conditionne le
procès de vie de l’individu en la société; cet invisible est déterminé par ce numen devenu inconscient qui pose l’immuabilité de l’être,
mais surtout de l’Un, de même qu’il est un procès insidieux auquel aucun
individu ne peut échapper. L’invisible est ce qui désigne ce qui dirige, à leur
insu, les hommes et les femmes.
Le vide est un support pour témoigner de l’invisible.
29 Le devenir de l’ontose s’effectue à partir de deux pôles, celui des parents et de leurs substituts, des instances sociales, pôle de la transmission de la dimension spéciosique, et du pôle de l’enfant déterminé par une adaptation et un refus, essai de se libérer. Les deux dynamiques s’interpénètrent.
Du pôle parental: renouvellement de la répression, du fait du refus constant de la naturalité, renouvellement de la confusion du fait que les parents manifestent leur dimension ontosique et un restant de naturalité mais, surtout, manifestent très souvent la confusion où ils furent placés eux-mêmes.
30 Dans le devenir de l’ontose la fonction du père, son rôle sont déterminants. D’une part son intervention confirme fondamentalement, à travers le phénomène du rejouement, ce qui a été vécu avec la mère mais, en outre, du fait qu’il opère dans une sphère quasi inconnue à l’enfant, celle de l’extériorité, il est fondateur au sein de la nouvelle dynamique qui, du fait de la spéciose-ontose, est une dynamique de séparation. C’est d’ailleurs en rapport à cela que les psychologues caractérisent sa fonction comme étant celle de la séparation, d’avec la mère, d’avec la nature. Or ceci est le résultat d’un renversement.
31 Le père est le signifiant-signifié d’un topos
existant où l’enfant sera en sécurité, accueilli. Il est celui qui permet en
réalité que la continuité se réalise entre topos utérin et topos externe. Du
fait de la lutte entre les sexes (elle-même rejouement
au sein de la séparation), il devient le séparateur, le justificateur du topos
externe dominé par la répression sociale, le principe de réalité, et le
représentant de la raison: ce qui permet d’ordonner le réel en fonction de la
séparation
31. bis. Dans le personnage du père s'exprime, se manifeste
au mieux l'ambiguïté du phénomène de vie altéré, lesté par l'ontose. Il
réprime, il sépare et protège. Et cette ambiguïté est redoublée du fait de son
absence pendant la période de vie intra-utérine de l'enfant, lors de sa
naissance et durant sa petite enfance; absence déterminée tant par les
phénomènes sociaux (éloignement dû au travail, par exemple) qu'ontosiques impliquant en particulier la transmission de la
séparation subie par le père lui-même lors de sa première phase de vie.
L'ontose du père réside dans l'incapacité à accéder à la pleine maturité de
l'homme. Inconsciemment il demeure un enfant en quête de sa mère, ce qui peut
le conduire à se poser en concurrence avec son enfant, d'où son absence, même
lorsqu'il est là, ici et maintenant.
Si l'homme recherche la mère dans la femme, le conduisant à
se comporter comme un enfant, celle-ci recherche le père en l'homme mais, du
fait de l'évanescence de celui-ci, elle tend à éduquer l'enfant en lui pour
qu'il transcroisse en père idéal - surtout pour
elle - et conjurer ainsi son vécu d'absence de père réel.
L'absence du père, sa non présence, renforcent la tendance à
l'attente du salut, et prédisposent à la mise en place de la dynamique
virtuelle et, donc, à la prégnance de la virtualité. *.
32 L’absence du père structure et fonde l’inaccessibilité au réel, la coupure sujet-objet, intérieur-extérieur, la dynamique de recouvrement, la recherche de l’utopie. Bref, tout ce qui nous éloigne de notre naturalité et qui vise à nous fonder autre: un être culturel, un être de culture.
33 Étant donnée la nécessité du père naturel, et l’envahissement du père culturel, ontosé, imposé par le corpus social, le père a une importance déterminante dans le développement de l’enfant, qui est, peut-être, accusée chez la petite fille.
34 Le phénomène de
transmission de la spéciose est l’œuvre non seulement des parents mais
également des grands-parents, par les composants de la double lignée
(maternelle et paternelle) à laquelle appartient l’individu; d’où il y a une
dimension individuelle, une de la lignée mais aussi une dimension ethnique [16] en quelque sorte,
nationale, puis géo-sociale (l’Occident par exemple),
enfin la dimension spécifique et celle d’être vivant.
Ultérieurement, l’école et l’organisme, où l’individu va travailler, ont une action déterminante [17] .
35 Les phénomènes
opérant lors de la mise en place de l’ontose, répression et détournement suivi
du renversement, vont être constamment réaffirmés tendant à séparer toujours
plus l’individu de la naturalité, ce qui est justifié par la théorie de la
nécessité de sortir de l’animalité.
La répression effectue une négation totale de l’être originel, et tend constamment à l’annihiler, induisant en l’individu la perception de la mort et réactive, chaque fois qu’elle opère, l’empreinte de la menace d’extinction.
36 Le détournement
va opérer sur la dynamique de confirmation qui consiste à entériner, à
considérer juste l’acte, le comportement de l’autre, particulièrement de
l’enfant, qui dés lors se sent accepté, reconnu. Avec l’intervention de
l’ontose, ce qui est reconnu ce n’est pas ce qu’effectue l’enfant à partir de
sa naturalité, mais ce qu’il réalise chaque fois dans l’artificialité du mode
de vie, c’est-à-dire dans la dynamique d’adaptation aux données imposées par
l’ordre social, par l’entremise de la mère. Chaque fois qu’il se comportera en
fonction des attentes des parents qui veulent, pour son bien, l’intégrer dans,
l’adapter à, le corpus social, donc chaque fois qu’il accepte l’être ontosé des parents, la reconnaissance s’opère. Donc
l’enfant n’est plus en continuité avec le phénomène vie, mais en continuité
avec ses parents qui apparaissent comme des terminus – parents supports du
phénomène vie.
Étant donné que les parents n’ont jamais été confirmés dans leur réalité, ils sont mis dans la dynamique de vouloir toujours l’être par leurs enfants. Leur propre réalité, devenue inaccessible, ils l’ont perdue.
37 Le double mouvement induit par la nécessité d’une domestication et par celle, inconsciente, de la part des parents d’être reconnus, immerge l’enfant dans le processus ontosique qui transforme le procès naturel de confirmation, concrétisation de la continuité, en un procès obsessionnel d’être reconnu.
38 Le détournement permet de s’éloigner du moment du numen, de s’en détourner et, par là, de fuir la souffrance; ce qui constitue le point de départ de la dynamique de recouvrement [18] qui est une distanciation. Le détournement induit la compensation; les manifestations d’amour compensent la souffrance du déchirement d’être détourné. L’immédiateté se trouve pour ainsi dire fracassée, expression profonde de la catastrophe.
39 La dynamique de réduction, directement connectée à
celle de la séparation d’avec le reste de la nature, est celle de la production
de l’individu et de la solitude. L’enfant n’est que ça: un être mis en
dépendance, en infériorité. A partir de là s’impose la dynamique de poser des
limites ainsi que l’impératif de devoir se contenter. La théorie ontosée postule que l’enfant n’a pas de limites, veut tout,
est insatiable etc. Mais si on est en continuité, le problème des limites ne se
pose pas, tout en percevant parfaitement où l’on est, du fait qu’on est
positionné dans le continuum, comme saillie émergeant du sein du phénomène vie.
C’est la perception de l’individualité-Gemeinwesen,
en même temps que de tout le phénomène du continu.
Limiter c’est réactualiser la rupture de continuité, c’est la rejouer.
40 Le complémentaire de la réduction est la récupération: l’adulte qui a, lors de son enfance, subi la désubstancialisation, la dépossession, récupère tout ce qui relève de l’hors-norme socio-parentale, dans l’affirmation de l’enfant, ce dont il fut privé en essayant de l’intégrer dans la dynamique de domestication. La récupération découle également de la pratique du détournement. Tout ce que l’enfant tendait à affirmer dans son idiosyncrasie est détourné puis intégré dans le procès de domestication, reconnu pour être utilisé (dépossession).
41 Du pôle de l’enfant, puis de l’enfant devenant adulte, il
s’effectue une réaction et non une action; ce qui s’exprime déjà dans le fait
qu’il doit interpréter ce qui advient et n’a pas de rapport avec son plan de
vie: production de fantasmes. A la racine de cette réaction se trouve un vécu
atroce: la souffrance de ne pas pouvoir abolir la discontinuité, cicatriser la
déchirure. Le procès de vie en tant que tel apparaît comme générateur de
souffrances. Vivre c’est souffrir. L’impossibilité de rétablir la continuité
fonde l’impossibilité d’accéder au réel [19] qui a donc trois fondements: la non effectivité de la
continuité avec la mère, son refus de la naturalité de l’enfant, de sa réalité,
et l’absence du père.
L’enracinement de cette impossibilité gît dans le traumatisme qui fait passer au-delà de la réalité et rend donc le réel impossible [20] .
42 Survivre et sousvivre consistent à éviter la souffrance et à essayer d’accéder au réel, ce qui est fondamentalement recherché, en une dynamique incluant une dimension contradictoire à l’aide du recouvrement.
43 Tout d’abord la dynamique se manifeste comme une
dynamique d’apprivoisement (d’atténuation) de la souffrance, et surtout de ce
qui la cause; donc apprivoiser la mère (numen). En
conséquence adopter un comportement qui permette d’être accepté par celle-ci,
en facilitant la domestication opérée par elle. La joie d’être accepté se
trouve toujours lestée inconsciemment par la souffrance de se perdre, de ne pas
être perçu dans sa propre réalité, de sentir qu’on ne peut accéder à une
affirmation qu’en étant détourné.
La dynamique d’apprivoisement de la part de l’enfant se développe en complémentarité avec celle de la domestication de la part des adultes (schémas comportementaux). En essayant d’apprivoiser les parents, et la souffrance interne, l’enfant entérine la domestication pour être accepté, reconnu.
44 Pour s’adapter à l’ontose des parents, l’enfant en arrive à opérer un renversement, inconsciemment recherché par eux. Il devient le père ou la mère d’un des parents, voire des deux.
45 Dans cette complémentarité des dynamiques, s’enracinent:
l’adaptation, l’autorépression, la servitude
volontaire. Cette complémentarité opère en connexion avec l’essai de l’enfant
de sauver les parents (l’enfant sauveur), ce qui va au-devant du désir
inconscient de ceux-ci. Pour ce faire, il est amené à se sacrifier,
c’est-à-dire à se séparer de son être originel, fondant l’empreinte: être
accepté c’est se sacrifier.
L’abandon de soi entraîne la nécessité de construire, organiser, un autre être. Le travail, en tant qu’activité plus ou moins torturante mais productrice, productrice de l’être ontosé, est la métaphore extériorisée de ce processus qui s’opère chez tout enfant, du fait de la domestication.
46 L’inaccessibilité du/au réel fonde la dynamique de la
symbolisation. On symbolise pour le rendre accessible. Le symbole est le
support du manque, du manque d’accès au réel.
La symbolisation est une opération qui aboutit à la réalisation de l’être irréel dont parle A. Janov, une composante fondamentale de l’être ontosé [21] .
47 La symbolisation ne relève pas seulement du domaine intellectuel. Elle opère également au niveau somatique. Les différentes maladies symbolisent les maux psychiques de l’être ontosé. L’état hystéroïde témoigne du même phénomène. Au début du siècle dernier, l’étude de l’hystérie donna lieu à la constatation de la parenté du symptôme avec le symbole. La symbolisation organique complète l’isomorphie d’expression du psychique et de l’organique. Entre les deux expressions il y a continuité car il n’y a pas deux domaines séparés: le corps et la psyché. Cependant l’ontose tend à poser des discontinuités en la totalité de l’individu (phénomène de cloisonnement, de compartimentation) [22] ce qui fonde la représentation du séparé et même le mode d’expression dissocié (l’expression dans la dissociation).
48 Le réel inaccessible signale la perte de l’évidence. En conséquence la réalité c’est ce qui doit être effectif, qui doit agir, sinon elle n’est pas saisissable.
49 La perte de la vie contemplative découle de celle de l’évidence. Spéciogénétiquement l’évanescence de la contemplation s’opère lors du passage de la cueillette à la production avec la mise en place de l’agriculture.
50 La métaphysique se développe en tant que discours métaphorique au sujet du réel inaccessible, et en tant que théorie recouvrante. Elle est la technique par excellence en vue d’atteindre le réel.
51 L’impossibilité d’accéder au réel se manifeste dans la confusion fréquente opérée entre réalité et vérité. Très souvent l’individu substitue réalité par vérité pour désigner soit lui, soit le monde comme si, par là, il pouvait transcender le réel qu’il n’atteint pas, et compenser l’effet du traumatisme.
52 Dans le jeu, l’homme, la femme, à quelque âge que ce soit, manifeste souvent son impossibilité d’accéder au réel.
53 Inaccessibilité au réel et indécidabilité se conditionnent réciproquement. La répression du désir – rejouement du refus de la part de la mère de la naturalité de l’enfant – réactive l’inaccessibilité à la réalité, et l’indécidabilité sur ce qui doit être effectué.
54 L’indécidabilité résulte non seulement de l’impossibilité
d’accéder au réel mais aussi de celle, qui lui est corrélative, de se
positionner. Cette indécidabilité dérive d’un vécu bien concret: la mère
ambivalente, ambiguë, paradoxale dans la mesure où, simultanément, elle refuse
et accepte, fascine et terrifie.
L’indécidabilité se fonde très souvent lors d’un vécu intrautérin, vecteur d’une empreinte, au moment où la mère ne sait pas si elle doit garder ou rejeter l’embryon en elle.
55 L’irrationnel affleure, pour ainsi dire, dans l’indécidabilité, comme dans le paradoxe, le dilemme, la contradiction, l’ambivalence, et réactive l’angoisse jamais éliminée.
56 Á la base de cette
indécidabilité se place un vécu qui peut être déjà un rejouement,
celui du moment de la présentation du fœtus dans le col utérin. Du fait de la
non présence de la mère, de la défaillance donc de la symbiose, qui se traduit
par un défaut de contractilité-élasticité des fibres
du col, le fœtus est placé devant un dilemme: avancer en forçant, ce qui peut
être dommageable pour la mère – support pour vivre le meurtre de la mère –
rester dans l’utérus et interrompre son propre développement, support pour
«vivre» la mort. Le dilemme résolu dans un sens ou dans un autre aboutit
toujours à un même résultat: l’échec. Le contenu de cet échec est une perte
pour l’individu: perte de ce qui est connu, rassure, est tangible, s’il sort de
l’utérus, perte de son épanouissement, de son devenir, s’il y reste. Dans les
deux cas c’est un support pour le vécu de mort.
Pour échapper au dilemme, l’individu se réfugie dans la transcendance, entérinant la non accessibilité au réel.
57 L’irrationnel lesté de la confusion (qui est comme en orbite autour de lui), se manifeste lors de toute remontée, surtout si celle-ci est déterminée par un événement positif, gratifiant, induisant une joie. L’expression: pleurer de joie, est une constatation: un homme, une femme, est heureux, heureuse, et pleure; mais elle témoigne d’une profonde erreur, d’une confusion, au sujet de ce que vit l’homme, la femme. La joie ressentie, ici et maintenant, diminue les résistances aux remontées, d’où l’invasion totale de l’individu(e) par la remontée de la souffrance de ne pas avoir été confirmé(e), aimé(e). Le phénomène hystéroïde superposé à celui de la manifestation de la joie, indique la remontée organique de la confusion originelle; confusion théorisée à l’aide de l’adage: les contraires s’attirent. Ceux-ci sont souvent les éléments constitutifs du phénomène confusionnel, de la confusion (thèse 81).
58 Ce n’est pas la pathologie de la communication qui engendrerait la pathologie mentale, telle qu’elle se manifeste par exemple dans la schizophrénie, comme tendent à l’affirmer les partisans de la théorie de la communication. C’est le traumatisme lié à la coupure de continuité qui provoque un refus de communiquer ou une perturbation plus ou moins puissante de l’aptitude à le faire. Cette aptitude se révèle en fait rarement de façon pleinement effective en chacun des hommes et des femmes.
La langue est déterminée par l’ontose. En retour, celle-ci est structurée par elle, voire codifiée, et en reçoit un cadre de référence.
59 L’inaccessibilité du réel témoigne de l’incomplétude où se trouve l’être ontosé; de l’incomplétude qu’il vit. Pour compenser, il tend à postuler l’existence d’un monde invisible, intermédiaire, peuplé de diverses entités, placé entre lui et la réalité qui lui échappe.
60 Inaccessibilité du/au réel et indécidabilité induisent la thématique du sens, sa quête, comme cela s’exprime de façon particulièrement expressive dans la recherche du sens de la vie.
C’est la coupure de la continuité fondant l’irrationnel qui, en définitive, impose la recherche d’un sens en tant que signification et que direction, comme celle d’un but, d’une finalité, apte à sécréter un sens.
61 Le réel c’est ce qui nous a échappé, ce qui irrémédiablement fut et ne fut pas perçu, sur lequel on s’est trompé, et sur lequel on a fondé nos fantasmes. La recherche de l’origine relève d’un essai d’approcher le réel, de l’atteindre, de lever la confusion, l’erreur. De façon isomorphe, la recherche de la vérité se déploie comme tentative d’exorciser l’erreur, le faux, la faute. Toutefois la confusion demeure pour ainsi dire irréductible et se réimpose dans celle entre réalité et vérité.
62 La coupure de la continuité induit le désir de la
retrouver. L’individu tente d’y parvenir à travers diverses conduites, comme la
confirmation qui est un euphémisme du rétablissement de la continuité. Étant
donnée qu’elle est rarement immédiate, elle demeure un palliatif, un ersatz.
L’acceptation est la forme réduite de la continuité. L’adaptation est la
recherche de la continuité hors de la vie immédiate, la vie naturelle.
La recherche de la reconnaissance exprime de façon encore plus nette le désir de continuité et le non accès à celle-ci, d’autant plus qu’elle implique la mise en place de techniques. Tout ce qui est entrepris, vise inconsciemment, à retrouver la continuité.
63 La coupure de la continuité induisant violence et confusion, il en résulte que la volonté de la rétablir s’exprime très souvent au travers des explosions de violence. Chaque fois qu’il n’est pas vu, entendu, perçu en tant que lui-même, l’enfant manifeste une violence intense où il veut tout casser, anéantir du fait même qu’il s’est senti anéanti lors de la coupure de la continuité.
64 La violence consiste fondamentalement en une technique visant à rétablir la continuité. Elle vise également à abolir l’irrationnel, ce qui est insupportable. Tant qu’il y aura de l’irrationnel en l’homme, en la femme, en l’espèce, la violence persistera.
65 Il en découle également que pour atteindre la continuité l’individu essaie constamment de sortir de la confusion, le plus souvent perçue de façon inconsciente, et qui le fait enrager. Le corollaire est le désir de se positionner et de repérer l’autre.
66 Avoir un discours adéquat, nommer correctement êtres et choses, participent de cette lutte contre la confusion. La manipulation du discours, de la nomination des choses, sont des techniques fondamentales pour le maintien du pouvoir politique, étatique [23] , donc pour la pérennisation de la sujétion, de la dépendance, racines de l’ontose au niveau de chaque homme, chaque femme.
67 Transcender vise à sortir du blocage opéré par la coupure, à franchir l’espace, le vide, le gouffre, induit par la réalisation de la discontinuité. Cela vise aussi à exister à partir d’un au-delà, à partir d’un point fixe [24] devant déterminer tout le devenir se déployant dans cet au-delà dénommé transcendance (thèse 55). Le même mot indique le mouvement pour y accéder.
68 Transcender pour atteindre un topos,
un lieu, où l’on soit enfin en sécurité. La transcendance tend donc à indiquer
le mouvement d’aller au-delà, et l’accès à celui-ci qui est dés
lors fondé.
Le topos est originellement le lieu d’où l’on surgit (l’utérus). Il devient ce qui engendre, le lieu où l’on pousse (idée de liberté), comme le montrent les mythes de l’autochtonie [25] .
69 La transcendance apparaît comme un phénomène compensateur et inverse du traumatisme. Elle opérerait un retour à ce qui nous a perforé [26] , mis dans l’émoi.
70 Sublimer c’est escamoter la séparation pour atteindre une continuité qui est, alors, virtuelle.
71 Le désir de continuité s’exprime dans l’idée de réincarnation, dans la croyance en des vies antérieures, voire dans la métempsycose, mais aussi dans l’espoir-croyance en une immortalité, en une «vie après la mort». Le désir d’immortalité exprime en fait l’impossibilité de vivre l’éternité, et révèle pleinement l’absence de continuité au sein de l’être lui-même.
72 La séparation effective, tacite ou non pleinement révélée, fait revivre à l’enfant la coupure. D’où son désir profond de la conjurer et, si elle advient, de la nier. Entériner cette séparation serait entériner une coupure en lui, serait remettre en cause ce à partir de quoi il dérive: la conception qui implique une union, l’effectuation d’une mise en continuité.
73 Inconsciemment, de façon plus ou moins ténue, la continuité est maintenue avec l’être originel qui peut, parfois, se manifester clairement, lors de moments privilégiés où aucune empreinte n’a été activée.
74 La non-remise en cause de la répression parentale permet le maintien apparent de la continuité. C’est une mystification qui permet de vivre dans l’illusion.
75 La continuité perçue comme un objet, un objectif à atteindre, ne peut pas être vécue en tant que donnée à laquelle on participe. Ce faisant on opère dans la dynamique de la manipulation.
76 Transferts et projections [27] sont des opérations inconscientes visant à établir une continuité. La discontinuité, en les interrompant, plonge l’individu dans la déréliction. D’où la recherche de supports [28] , qui peut devenir effrénée, et le déchaînement de violence lors de leur perte.
77 En général hommes et femmes ont peur du discontinu qui réactive, inconsciemment, le traumatisme originel. De là découle le refus de la nouveauté, support d’une remise en question qui insécurise parce qu’elle ébranle toute la construction que l’individu a opéré pour survivre et sousvivre.
78 Le discontinu peut se percevoir comme l’évanescent et donc comme ce qui l’oppose au permanent. Dans ce cas il exerce une certaine fascination comme le révèle l’importance que revêtent apparition et disparition de phénomènes naturels, eux-mêmes supports pour percevoir naissance et mort.
79 La discontinuité est recherchée dans le cas du mystère car, en y accédant, l’individu peut, enfermé en lui, être protégé du monde en place (dynamique apotropaïque). Elle est recherchée également afin de mettre un terme à une situation devenue trop intolérable et qui perdure sans qu’apparaisse clairement une issue, et que s’impose l’idée (espoir) qu’à partir d’elle une autre dynamique de vie sera possible.
80 Au niveau individuel, comme au niveau de l’espèce, une rupture trop radicale, une discontinuité trop soudaine, se révèlent néfastes parce que, du fait de l’effondrement subit des prothèses, des défenses, et de l’évanescence des supports, d’immenses remontées [29] se produisent génératrices de violences difficilement contrôlables, entraînant une impossibilité de se positionner, signe d’une immense crise de la présence.
La discontinuité qui doit advenir devrait se dérouler au cours d’un procès continu d’élimination de tout ce qui inhibe le développement de l’individualité, de l’espèce, à partir d’une inversion totale du comportement des hommes et des femmes.
81 La plus grande nocivité de la remontée dérive de sa réactualisation de la confusion (thèse 56) et de l’insécurité originelles. L’état où se trouve l’être affecté d’une remontée est un état confusionnel. Pleurer de joie, revenons-y, c’est vivre une confusion. La joie vécue intensément (et elle l’est d’autant plus que son occurrence est faible) diminue les résistances de l’individu à la remontée du refoulé. En conséquence, au moment où, consciemment, la personne vit sa joie, la remontée peut se produire, phénomène inconscient qui se manifeste à travers une sorte d’épiphanie, un symptôme: les pleurs [30] .
82 L’être séparé de celui originel, l’être adapté, domestiqué, pénétré par l’ontose, imbibé par elle, est donc soumis aux remontées. Toute sa dynamique de vie va être déterminée par le désir de les éviter. En cela il sera secondé par les mesures prises au sein de la société où tout est fait pour éviter qu’elles ne se produisent du fait de leur caractère éminemment dangereux pour l’ordre social, car elles remettent en cause la coexistence entre les individus. Lorsque la répression par la morale n’est plus suffisante, n’est plus utilisable, alors s’impose un contrôle [31] .
83 Éviter les remontées c’est survivre et sousvivre [32] . A l’échelle sociale le recours à la neutralité permet d’y parvenir dans une certaine mesure [33] . Elle implique l’élimination de toute dimension émotionnelle, affective, qui pourrait réactiver une empreinte. Elle nécessite également de ne pas porter de jugements. Mais étant donné que le phénomène ontosique n’est pas perçu, cela aboutit à l’impossibilité de se positionner et à une abstraïsation, autre forme de séparation, de dépossession.
84 L’anticipation est une pratique intellectuelle souvent utilisée afin de conjurer une remontée chez l’autre. Anticiper revient à faire ou dire avant que l’autre ne fasse ou dise. Anticiper conduit à ne pas écouter, à interrompre l’autre afin de lui prêter le discours qu’on voudrait qu’il tienne.
Dans des situations complexes où se trouvent impliquées plusieurs personnes, l’anticipation implique l’effectuation d’une identification qui peut être multiple, c’est-à-dire que l’individu peut s’identifier à diverses personnes. Cela le conduit, en se mettant à leur place, à anticiper leur dire ou leur faire ce qui, selon lui pourrait désamorcer une remontée en la personne support du transfert d’un parent auquel il s’est également identifié.
85 Une défense puissante contre la réinstauration et les remontées, consiste en la pratique du cloisonnement, de la compartimentation, qui contribue à implanter des discontinuités à l’intérieur de l’individu, entre les divers niveaux de son expression ainsi entre celle organique et celle des émotions, entre celle-ci et celle des sentiments et, enfin, entre cette dernière et celle des pensées. Cette pratique se retrouve dans le domaine intellectuel avec la méthode de division des difficultés, avec la séparation des problèmes posés par un événement, par exemple. On sépare en quelque sorte pour se sauvegarder; c’est un support pour diviser le mal qui est en nous.
86 Le cloisonnement, la compartimentation, expriment la division de l’être afin de retrouver la multiplicité et éviter le solipsisme, la réduction dans une ipséité.
87 L’insuffisance
des divers phénomènes tendant à protéger l’individu contre la souffrance,
l’instabilité, les rejouements, les remontées,
conduit celui-ci à se construire un autre être, entrer dans une autre dynamique
de vie qui va recouvrir l’ancienne, l’ensevelir en quelque sorte, afin qu’elle
ne se manifeste plus. Grâce au travail il va pouvoir opérer un déversement, le
soulageant de sa rétention.
Le recouvrement tend à inhiber la réinstauration de ce qui fut.
88 Recouvrir c’est tendre à entrer dans une activité où le réel soit accessible; d’où l’importance, au niveau de l’espèce, des mythes et rites, de la religion, de l’art, de la politique, de l’économie, de même que de la philosophie et de la science, mais aussi de la spiritualité ou de l’occultisme. De là aussi l’essentialité de travailler – tout particulièrement en Occident [34] – d’organiser, de structurer.
89 Recouvrir c’est atteindre la stabilité, la sécurité, parce que c’est opérer par-dessus le vide, déterminé par la coupure de continuité, comme s’il avait été comblé [35] . Le recouvrement s’exprime au travers du travail; il en constitue la justification inconsciente.
90 Le recouvrement
augmente la tension de rétention. En conséquence, inconsciemment, l’individu a
tendance, pour compenser, à se déverser. Toute activité se présente comme un
support de déversement de tensions retenues. Le même phénomène opère lors des
interventions verbales qui, de ce fait, sont lestées de surcharges provoquant
une gêne, voire une remontée chez l’interlocuteur.
Les diverses formes
de jeux, ainsi que les jeux de mots (mots d’esprit), les calembours, les
plaisanteries, l’humour, et même l’ironie sont prétextes à déversement.
Le moment de réalisation de l’acte sexuel se présente comme l’événement par excellence où il opère.
91 Le recouvrement
opère dans la même dynamique que le refoulement, dans la mesure où il tend à
enfouir ce qui indolore, mais cela s’opère à travers des activités conscientes
(phénomène compensatoire). D’où l’exaltation de la conscience et la recherche
constante à accroître son domaine, sa sphère. L’accroissement du contenu de
conscience, concomitant à celui de sa forme-contenant
est la compensation nécessaire à l’accroissement de ce qui est inconscient,
posé comme l’inconscient.
Conscience et inconscient sont des structures ontosiques, expressions de la discontinuité intériorisée, qui inhibent le devenir des hommes et des femmes en les encombrant.
92 L’inconscient est un produit de la répression, du refoulement, de la rétention. Par suite du maintien de la sortie de la nature et donc de la répression parentale, le phénomène ontosique se renouvelle à chaque génération. Chacun transmet l’ontose à son descendant sans que s’impose l’intervention d’un inconscient collectif.
93 La conscience
dérive également de la répression, qui réactive la coupure de continuité, qui
enduit l’effort de l’individu pour la rétablir, et la résistance qu’offre
l’autre à sa réalisation. Dit autrement, la conscience surgit de l’effort pour
maintenir la continuité – donc elle est médiation (faire) – et de la résistance
qu’oppose le numen à son accessibilité. Dit
autrement, encore, la conscience résulte de la synthèse de cet effort, de ce
faire, et de cette résistance qui la pose. En effet, se poser en s’opposant
implique la manifestation d’une résistance.
Effort, résistance, impliquant intérieur et extérieur en tant que domaines séparés sont isomorphes à action et réaction. Le travail apparaît en tant qu’articulation entre effort et résistance, comme entre action et réaction, et la conscience comme l’interface entre l’intérieur et l’extérieur, qui a été intériorisée.
94 Proclamer l’essentialité de la conscience c’est revendiquer la séparation, poser un séparé, un contenu impliquant une rétention; c’est mettre en place des aspérités, des saillies qui permettent la manipulation.
95 La conscience, expression de la confusion où est placé l’individu, sépare l’individu du réel et l’unit à lui, grâce à une opération, une manipulation. Celui-ci puise en elle, les éléments, les outils nécessaires à la résolution des difficultés qu’il rencontre.
96 En tant qu’être possédant une conscience, on est fondé être apte à être manipulé. La manipulation est l’expression la plus patente de l’intériorisation de la technique.
97 Le recouvrement opère également dans une dimension d’évitement. Ce qui est fait, exécuté, mis en place, se révèle avoir une dimension apotropaïque qui se présente comme un détournement inverse. C’est une activité pour détourner le mal, le mauvais sort, ce qui fait mal; c’est tenter de conjurer ce qui est vécu comme fatalité, destinée.
98 Le recouvrement peut se manifester également de façon contradictoire, au travers de l’amplification de ce qui a été vécu, de ce qui a profondément perturbé. Cela opère à l’aide de fantasmes, de mythes, et cela s’impose dans la littérature, et dans la dynamique thérapeutique [36] . Leur accumulation recouvre finalement le vécu douloureux. C’est contradictoire parce qu’à la base se trouve le désir de parvenir à percevoir ce qui traumatisa, qui fut refoulé, recouvert par un vécu ultérieur qui ne confirma pas le traumatisme ou pas suffisamment pour le réimposer; traumatisme donc difficilement accessible de façon immédiate et qui a besoin d’être grossi par le rejouement et par les phénomènes opérant comme un microscope psychique.
99 Au cours des divers moments de grossissement du phénomène perturbateur initial, le procès de connaissance opère. Hommes et femmes essayent de comprendre ce qui est advenu. D’où l’apparente répétition qui s’impose au cours des siècles, alors qu’en fait, à chaque nouvelle reprise du thème de recherche, il y a un approfondissement rendu possible par la puissance du rejouement opérant au niveau de l’espèce [37] .
100 Une des fonctions du rêve réside dans la réalisation de l’amplification qui opère soit de façon immédiate soit à travers la symbolisation. D’un point de vue général, l’activité onirique signale que nous sommes constamment en train de chercher une solution à ce qui nous tourmente [38] .
101 Recouvrir implique travailler, produire, faire, interpréter, anticiper, de telle sorte que l’individu ne s’affirme plus dans l’immédiateté de son propre procès de vie, à partir duquel il pourrait «faire», mais à travers un procès qui lui a été imposé (répression), ou qu’il s’est imposé (recouvrement) afin de ne pas rejouer (nécessité de l’anticipation et de l’interprétation), de conjurer.
102 Recouvrement, refoulement et rétention deviennent lors de la vieillesse de moins en moins opérationnels du fait de la perte d’énergie. La retombée en enfance du vieillard, de la vieillarde, constitue le dévoilement de ce que l’individu(e) a toujours été: l’enfant sous terreur. Ce qui advient en premier c’est la diminution de puissance du recouvrement liée à la perte d’activité (retraite) et à l’isolement qui lui est souvent corrélative. L’aide des autres pour l’entretenir apparaît nettement dans la longévité très souvent plus importante des hommes politiques, des vedettes ou des dignitaires de l’Église ou d’institutions similaires. Être reconnu permet de recouvrir pour ne pas percevoir l’horreur subie, vécue.
103 Afin de ne pas rejouer, l’homme, la femme, a tendance à jouer, et par là à essayer d’échapper à la dépendance, au déterminisme du rejouement. Le jeu, certes, a un fondement naturel, mais il opère – dés l’enfance – en tant que support d’opérateur de rejouement. L’enfant manipule des jouets – l’adulte divers objets, diverses idées – tout en étant le jouet d’un mécanisme infernal. Au cours de notre vie, nous sommes joués parce qu’inconsciemment nous ne faisons que rejouer.
104 Le jeu est un support essentiel non seulement pour tenter de conjurer, mais pour recouvrir, pour compenser la vie affective, active. Le jeu est de ce fait en rapport étroit avec l’illusion vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Il fonde la possibilité de l’actualisation des rôles. D’où, également, l’essentialité du théâtre parlé ou chanté, du cinéma, de la télévision, des jeux de rôle, de la virtualité.
105 La rébellion, le refus, peuvent participer à la dynamique de libération-émergence, mais ils contribuent le plus généralement à imposer l’ontose parce que la volonté de déjouer conduit le plus souvent à rejouer de façon encore plus puissante. D’autre part, s’édifier en niant constamment les phénomènes qui se réimposent à nous, englue dans la dynamique ontosique. Car la négation de ce qui est, contribue à l’affermir. En outre elle maintient la dualité, fondement de l’ontose.
106 Lutter contre la réduction où l’on est placé; sauver
quelque chose, préserver son originalité [39] , demeure dans la dynamique ontosique
parce qu’elle maintient un équilibre qui régénère constamment la dualité.
Résister c’est entériner.
107 Les phénomènes d’adaptation et de rébellion déterminent les différentes phases de la vie de l’ontosé. Jusque vers cinq ans, l’individu essaie d’imposer sa propre réalité, tout en s’adaptant. Ensuite il abdique et l’adaptation l’emporte. Sept ans est considéré, en Occident, comme l’âge de raison (l’âge où l’on se fait une raison). Le surgissement de la sexualité la remet en cause; son énergie permet à l’individu de tenter à nouveau d’être reconnu en tant qu’être naturel, divers des autres. La puberté est une période de puissantes remontées et d’intenses rejouements, bien que l’individu essaie fondamentalement de déjouer, de conjurer. La révolte peut perdurer, plus ou moins estompée, tout au long du reste de la vie. C’est le cas le moins fréquent. La majorité des individus fait des compromis, s’adapte. Ultérieurement diverses remontées, divers déversements peuvent à nouveau perturber l’équilibre atteint. Grâce au mariage, ou à toute autre forme d’union, et grâce à l’obtention d’enfants, hommes et femmes recouvrent et rejouent. Chez l’homme, la crise de la quarantaine témoigne de l’insuffisance du recouvrement; chez la femme cela s’opère vers la trentaine. Le nouvel équilibre ultérieurement atteint est à nouveau remis en cause vers la soixantaine chez l’homme et lors de la ménopause chez la femme. Les phases de crise se présentent ensuite de façon de moins en moins espacées, à cause de la perte de plus en plus grande de l’efficience du recouvrement, jusqu’à la mort, rejouement final [40] .
108 La mise en place, l’instauration de l’ontose, s’effectue avec l’institution des rôles, ce qui relève en grande partie de la spéciose. En effet elle est en rapport avec la séparation des sexes, la fondation de la mère et du père, ainsi que de l’enfant en tant qu’objet de contestation et de signe de pouvoir (matriarcat et patriarcat).
109 Les rôles de l’homme, de la femme, en tant que père, en tant que mère, se greffent sur des fonctions plus ou moins autonomisées: la procréation pour la femme, la protection (de l’enfant et de la mère) pour l’homme qui devint un guerrier.
110 Les rôles interviennent dans la dynamique de recouvrement, qui est en même temps celle de vouloir déjouer. Schématiquement et en substance, on a ceci. En tant que mère, la femme, grâce à l’enfant, vise à retrouver une totalité et une continuité dont elle exclue l’homme, et devient un être plus ou moins asexué. L’enfant est support d’identification et peut devenir celui du père idéal. L’homme, en revanche, au travers d’une sexualité qui tend à être exaltée et dont la composante essentielle est une libération de tensions, est constamment à la recherche d’un support pour être en continuité avec sa mère. S’il le trouve, lui aussi devient un personnage plus ou moins asexué.
111 La dynamique de la femme en tant que mère induit chez l’homme en tant que père une dynamique complémentaire, celle de la concurrence avec l’enfant pour l’accès à la mère. Elle s’initie, au départ, du pôle du père qui se sent exclu par la mère, exclusion qui active l’empreinte de ne pas avoir été accepté.
112 La dynamique inconsciente qui conduit hommes et femmes à procréer afin de rejouer, et de compenser le manque d’amour reçu dans leur prime enfance, fonde le rôle d’enfant. En effet le devenir de l’enfant est déterminé par la réduction au rôle de support, de donateur et de sauveur, en laquelle, inconsciemment, il est vécu [41] .
113 Du fait d’une antique division entre les sexes, les hommes ont abandonné leur participation à l’engendrement de l’enfant. En conséquence la femme est seule en rapport avec le nouvel être durant la gestation, et l’homme n’est père qu’à partir de la naissance. Là se fonde et s’enracine l’empreinte de l’absence du père. Dans une certaine mesure l’homme s’est lui-même exclu de la relation à l’enfant entraînant comme conséquences un surcroît de charge pour la femme, qui la justifie dans son rôle de mère, parent absolument prépondérant, et la tendance de l’homme à s’imposer ultérieurement comme étant le parent essentiel.
L’absence du père et la tendance à l’envahissement de la part de la mère ont une lointaine origine et sont des fondements de l’ontose pour chaque nouvel être humain-féminin advenant [42] .
114 Pour les êtres ontosés, la sexualité s’impose comme un opérateur d’union en vue de rejouer, tandis que les sexes opèrent comme opérateurs de positionnement et de référents pour la séparation.
115 Le devenir du capital et celui à la virtualité amènent
l’évanescence des rôles: la femme tend à être libérée (dépossédée) de la
maternité et à devenir une guerrière; l’homme peut envisager de réaliser le
phantasme d’enfanter et perd sa prérogative de protecteur, de guerrier, de même
qu’il tend à perdre son rôle de séparer la mère de l’enfant, en faisant entrer
celui-ci dans le champ de la culture.
L’évanescence des rôles liée à l’autonomisation des
fonctions déterminée par une séparation toujours plus grande vis-à-vis de la
nature, laisse le champ libre à l’opérationnalité d’un mécanisme d’éducation-domestication, médiatisé par diverses
institutions qui opèrent toujours plus tôt dans le champ de vie de l’enfant.
116 L’évanescence des rôles conduit à une immense confusion, rejouement de celle originelle. Par là, l’espèce se rapproche de ce qui détermina sa spéciose.
117 De même que les parents aiment leurs enfants mais ne
parviennent pas à exprimer pleinement leur amour à cause de la dynamique de
répression de leur naturalité, de même hommes et femmes des diverses générations
successives, en un immense rejouement, s’aiment mais
ne peuvent pas, à cause de divers rejouements, des
remontées déterminées par ce qu’ils ont subi enfants, exprimer leur amour. Leur
union se traduit le plus souvent, après une phase plus ou moins longue
d’entente (phase de latence de l’expression de l’ontose), par une coexistence,
ou par un déchaînement de violences avec toutes les gradations entre les deux.
Si les schémas comportementaux sont complémentaires, il en résulte une entente, un couple perdurant; si les schémas sont similaires, alors s’impose la violence.
118 L’élément unitaire de l’espèce se manifeste en tant que
couple homme-femme [43] . En conséquence des phénomènes de détournement, d’inversion
et de renversement, il s’affirme comme support de l’antagonisme, de la
contradiction, de la déchirure; comme le support de rejouement
fondamental de la déchirure-séparation d’avec la
mère.
L’attachement au sein du couple exprime la dépendance – rejouement de celle originelle – et non l’union intime où l’homme, la femme, maintient son individualité et sa toute puissance. Ceci s’exacerbe quand de l’attachement, on passe à la fusion.
119 Le couple est un support pour rejouer l’indécidabilité. En effet lorsqu’un homme et une femme s’unissent en couple, réactualisent-ils celui qui fut nécessaire à leur propre conception, et qui leur permettra de concevoir un enfant, assurant ainsi la continuité du procès de vie de l’espèce, ou rejouent-ils les couples mère-enfant, père-enfant? En même temps il est le support pour vivre une confusion entre conception et naissance. Pour en sortir, inconsciemment, on tend à privilégier la seconde aux dépens de la première.
120 L’être ontosé tend à se créer un monde compatible avec son mode de vivre, un monde où règne la dépendance et l’assistanat. Ici, encore, évidemment, s’impose le devenir de la spéciose et toutes les organisations recouvrantes, conciliantes et répressives que l’espèce a produites: les divers types d’États, d’institutions rassemblant des fidèles en une religion donnée, d’associations, de regroupements etc.
121 Aucune manifestation de l’individu ne peut être
entièrement réductible à l’ontose ou à la naturalité. On a affaire à un mélange
comme, selon les manichéens, celui entre le bien et le mal. Toutefois, on peut
affirmer que des manifestations comportementales comme l’humour ou l’ironie,
des sentiments comme la jalousie et la honte, relèvent presque en totalité de
l’ontose.
La méfiance et la défiance sont des formes perverties de la vigilance, activité qui permet le maintien de la présence.
122 Le phénomène d’autonomisation tend à imposer l’ontose en tant que seule modalité de manifestation de l’individu. Ce phénomène est isomorphe à celui qui se déroule au sein de l’espèce. C’est celui qu’on voit s’affirmer avec la valeur, puis avec le capital et dont le final débouche dans la virtualité.
123 La mort de l’être ontosé ne
relève pas pleinement d’un phénomène naturel. Elle est le rejouement
ultime où l’être originel finalement s’abolit. A des degrés divers, ce rejouement est celui d’un avortement [44] , d’un échec, puisque l’être originel n’a jamais pu parvenir
à s’épanouir, à aller au bout de son accomplissement.
Hommes et femmes n’ont pas peur de la mort, à laquelle ils n’accèdent pas depuis des millénaires, mais de cet avortement inévitable, événement dont l’inexorabilité engendre une profonde angoisse.
124 L’ampleur de la mort depuis le xxe siècle, tant en ce qui concerne la peur
qu’elle inspire, sa fascination ou sa difficulté de réalisation (maintien
médical de la survie grabataire), témoigne de l’importance impressionnante que
l’ontose a prise en chacun, chacune.
Le suicide traditionnel se généralise, et celui en tant que sacrifice (rejouement) visant à faire triompher une cause (les kamikazes), tend à devenir plus fréquent. Le suicide s’impose comme une conjuration de l’avortement et l’affirmation d’une voie transcendante pour accéder à un monde où l’être originel pourrait s’épanouir [45] .
125 Au cours de la vie on opère tour à tour en tant que victime et en tant que bourreau. Ce ne sont ni les victimes, ni les bourreaux qui sont les sujets de ce qui s’effectue, du mal, mais un procès, un mécanisme, l’ontose qui prend sa racine dans la répression parentale elle-même déterminée par le devenir hors-nature. Donc les hommes et les femmes participent tous à un mal qui est le phénomène ontosique qui se déploie à partir de la séparation de la nature et s’amplifie au fur et à mesure que cette séparation devient plus importante, plus fondamentale. Dans le mal il y a des éléments rationnels et irrationnels et même quelque chose qui est irréductible à ceux-ci, parce que le mal c’est l’ontose elle-même.
126 Se lamenter conduit à se percevoir uniquement en tant
que victime et à attendre un salut externe. Accepter, voire exalter, le procès
de vie sociale, c’est entériner le rôle de bourreau, et croire que le mal peut
être éliminé par la répression.
La rébellion s’affirme souvent comme une simple transcroissance de la servitude volontaire.
127 Lamentation, victimisation vont de pair avec l’attribution aux autres, ici et maintenant, de la responsabilité des troubles, des échecs que l’individu subit. En réalité, inconsciemment, c’est lui qui se met dans la situation idoine pour rejouer ce qu’il a subi de la part de ses parents. En outre, en attribuant la responsabilité aux autres, il active chez eux l’empreinte de la culpabilité. L’ontose se perpétue à travers ce mécanisme infernal qui la constitue, souvent désigné fatalité, destin ou karma.
128 Pour expliquer l’existence du mal on a postulé une méchanceté originelle de Homo sapiens, une cruauté, une agressivité. Or, c’est l’inverse, c’est l’existence du mécanisme en tant que tel, du mal en procès, qui détermine les différentes formes de violence et les capacités à l’exprimer, l’effectuer: la méchanceté.
129 Le bien, le mal, avec toutes les notions qui leur sont connexes, forment le contenu de la conscience morale, une forme de la conscience qui se prête le mieux à la dynamique de la manipulation, qui recourt essentiellement à la culpabilisation.
130 Le mal dérive d’une sommation de maux induits par une dynamique d’errance où s’imposent détournement et dévoiement du naturel. L’autonomisation et l’hypostatisation constantes, au cours des siècles, fondent le Mal, agent opérant en la spéciose et l’ontose, en tant qu’antagoniste fondamental du Bien, engendré par un procès similaire.
131 Une des raisons du succès de la science expérimentale réside en la tentative que les hommes et les femmes, en Occident, effectuèrent en vue d’éliminer une approche de la réalité en fonction du bien et du mal, pour éviter que le réel soit un support de l’un ou de l’autre, ce qui entraîna le bannissement d’une théorisation en fonction des valeurs.
132 La science expérimentale s’est imposée en tant qu’activité de recouvrement par excellence. Son envahissement actuel par l’éthique signale l’échec final de celui-ci, et donc de celle-là.
133 La dissolution de l’ontose au cours du procès de libération-émergence concernant tous les membres de l’espèce aboutira à la dissolution du mal. Cependant il faut que chaque membre tende à devenir réellement une individualité-Gemeinwesen, sinon le phénomène, s’opérant dans la séparation, ne pourra pas aboutir à son achèvement.
134 Toute théorisation au sujet de tares cachées, d’une composante d’ombre, de côtés honteux, inavouables, de déterminations bestiales conçues comme des infamies, d’une dimension satanique etc., plus ou moins constitutifs de l’homme, de la femme, est un discours interprétatif de l’ontose qui l’entérine en tant que procès.
135 Il n’y a pas une innocence originelle, une bonté originelle etc., parce que cela implique encore la dynamique ontosique en niant ce qui est réalisé à cause d’elle. Ce qui s’imposera c’est une dynamique naturelle qui ne relève d’aucune morale.
136 On n’a pas à lutter contre le mal qui est toujours placé sur un support bien déterminé, ce qui a conduit à la théorisation de la lutte des classes, entre les générations, au racisme etc. Ainsi il n’y a pas à diaboliser les parents ni à prôner une lutte des enfants contre ceux-ci. Cela inhiberait en particulier toute possibilité de libération-émergence des adultes qui sont devenus parents, en les mettant en présence d’une indécidabilité et d’une confusion: doivent-ils opter pour l’enfant ou pour le parent?
137 L’abandon du procès révolution est l’abandon de la lutte
contre, pour, en revanche, favoriser une dissolution, celle du monde de
l’ontose en nous et hors de nous, en abandonnant ce monde, et accéder à la
perception plénière du phénomène spécio-ontosique qui
affecte l’espèce depuis des milliers d’années.
Une dynamique similaire s’effectuera en ce qui concerne les autres formes de lutte contre le capital, contre le monde organisé par lui.
138 Le capital est la représentation-concrétisation de l’ontose et de la spéciose étant donné qu’il opère pour l’individu comme pour l’espèce. Il est l’ontose-spéciose devenue sujet, anthropomorphisée, qui détermine la vie des hommes et des femmes. Grâce à lui l’ontose-spéciose devient visible [46] .
139 Le procès de constitution du capital inclue le phénomène de l’aliénation. Tant qu’il y a aliénation il n’y a pas de folie. Mieux, en produisant le capital, l’espèce a constitué un être autre à partir d’elle-même, comme pour se distancier du mal qui la ronge. En revanche, avec la mort potentielle du capital et le développement de la virtualisation, l’espèce tend à se replier sur elle-même, à un solipsisme pour lequel elle a eu d’ailleurs diverses tentations au cours de son devenir. La folie c’est l’ipséisation, la réduction à soi, l’impossibilité de tout devenir. Ce qui est théorisé, en particulier, avec la fin de l’histoire, dans la mesure où elle posée comme la fin du devenir.
140 Ni pardon, ni condamnation – de même que ni
idéalisation, ni diabolisation de la nature – mais nécessité de percevoir de
façon implacable tout l’invisible, toute l’ontose, tout ce qui a été posé, vécu
comme le mal sans réellement le percevoir. La réconciliation également ne
s’impose pas, car réconcilier c’est conserver en
recouvrant [47] .
Ni sauver, ni rédimer, mais atteindre notre naturalité, la continuité avec le procès de vie. Ce sera la dissolution de l’ontose et la mise en branle d’un procès de régénération opérant en profondeur pour tout homme, toute femme.
141 Afin de survivre et sousvivre
l’espèce humaine, particulièrement en Occident, recourt à une psychologisation
généralisée, dénotant par là que l’insécurité initiale, la menace primordiale
sont toujours opérantes, et que donc la sortie de la nature n’a pas permis
d’accéder à la sécurité, à la protection. Cet échec oblige à voir non seulement
l’ontose, mais son insuffisance, le risque de la folie et les dangers de la
virtualité.
Á partir du saisissement de ce moment singulier une autre dynamique de vie peut se déployer.
142 Toutes les solutions ontosiques (tant sur le plan organique qu’intellectuel) sont, au niveau de l’adulte, des aberrations qui inhibent l’accomplissement de son procès de vie, qui activent son mal être, mais elles furent, à l’origine, les seules aptes à assurer sa survie et sa sousvie (que ce soit à l’état d’embryon, de foetus, ou de bébé).
143 Le revécu authentique du traumatisme et de ses rejouements, ainsi que le ressenti profond de l’immense souffrance induite, bien positionnée dans le passé et distanciée de ce qui advient, ici et maintenant, peut permettre de désactiver les empreintes et de se libérer. Toutefois si la réalité des rapports entre hommes, femmes, enfants, ne change pas, l’émergence de cet être libéré ne peut pas être confirmée, faisant resurgir la contradiction, et donc le possible de la réaffirmation de l’ontose. La libération-émergence ne peut s’actualiser qu’avec la fin de la millénaire errance de l’espèce, la fin de la spéciose, l’élimination de la société communauté actuelle.
144 L’être libéré est en fait l’être originel, avec son plan
de vie, et donc sa dimension Gemeinwesen, qui furent
masqués par l’immense souffrance déterminée par la coupure de la continuité. En
conséquence, la dynamique de libération-émergence ne
peut pas se réduire à un revécu des traumatismes, à un profond ressenti des
émotions aux divers niveaux de l’individu. Elle ne peut être totale et réelle
que si l’on se sépare du moment initial fondateur de la souffrance, créateur de
l’empreinte de l’attachement et du blocage, et qu’on retrouve la continuité, en
nous-mêmes, avec l’être originel, ainsi qu’avec nos semblables, avec tous le
procès de vie, et donc avec le cosmos.
La mise en continuité fonde l’émergence.
Février 2002
* * *
Ces thèses visent à exprimer ce qu’il y a de saillant,
d’apparent, dans le comportement de l’homme, de la femme, ontosé(e).
Elles ne sont pas exhaustives mais forment un point de départ pour une
investigation au sujet de ce comportement se développant en connexion intime
avec la mise en branle d’une dynamique de libération-émergence.
Elles sont également nécessaires pour pouvoir exposer la dynamique de vie
délestée de l’ontose-spéciose, et donc mettre en
évidence ce que peut être l’individualité-Gemeinwesen.
Cet exposé ne peut se déployer qu’en abandonnant ce monde. Ce qui est
fondamentalement visé, c’est le procès de vie réel, et donc le devenir
ultérieur à l’espèce devenant totalité-Gemeinwesen,
et celui à l’individualité-Gemeinwesen.
Ajout de mars 2007
[1] Le
développement de l’ontose dans les autres aires géo-sociales
devra faire l’objet d’études particulières. Dans Émergence de Homo Gemeinwesen, au sein du chapitre abordant de
façon récapitulative les divers traumas ayant affecté l’espèce, nous
intégrerons ces diverses études.
La dissolution tant de la société-communauté que de l’individu s’accompagne d’un
grand développement de violence qui, inconsciemment, vise à rétablir la
continuité d’un procès.
[2] Du point de vue de l’ontogenèse,
l’individualité traverse une phase d’utérogestation,
puis une phase d’haptogestation. Du point de vue de
la spéciogenèse, l’espèce a présenté une phase de naturoévolution, commune à tous les êtres vivants, caractérisée
par le développement d’organes dont le tout fait l’organisme spécifique. Le
milieu joue certes un rôle important, mais le résultat concerne toujours
l’espèce en sa dimension organique et psychique. En revanche, avec le phylum Homo,
s’impose une autre évolution qui se caractérise par la production d’organes
qu’on peut dire externes au corpus organo-psychique.
Ces organes sont les outils au sens large qui permettent une mise en continuité
puissante de l’espèce avec son environnement. On peut parler d’une meilleure
intervention, certes, mais cela m’apparaît comme étant une participation plus
efficace avec la nature, potentiellement avec le cosmos.
[3] Il
est certain que le bouddhisme ne se réduit pas à cela.
[4] Han-Fei-tse ou Le Tao du Prince, présenté et traduit du chinois par
Jean Levi, Ed. Points-Seuil,
1999.
[5] Dans
Émergence de Homo Gemeinwesen, j’aborderai le
cas des autres aires.
[6] C’est un thème abordé dans la partie
publiée de Émergence de Homo Gemeinwesen qui
sera amplement développé dans la suite qu’on souhaite donner à ce texte.
[7] La
science, c’est-à-dire la science expérimentale, particulièrement à travers la
mise en place des sciences humaines, a subi également un détournement et un
renversement. D’un ensemble théorico-pratique visant
à une connaissance en vue d’une maîtrise de la relation à la nature, au cosmos,
on est passé à un ensemble théorico-pratique
produisant une connaissance visant à dominer hommes et femmes.
[8] D’où, en philosophie, l’abandon d’une
théorie essentialiste pour tendre à affirmer la prééminence de l’existence;
l’essence devenant une conséquence de celle-ci. Ce passage est en rapport
également avec la prépondérance prise par le concept de production (et donc
production de soi-même) en rapport au mouvement de la valeur, puis du capital.
Ainsi J.-P. Sartre affirme que l’existence précède l’essence et que l’individu
se pose à partir du néant.
[9] Ceci
fonde la thèse que l’homme n’est que s’il s’arrache à la nature. La technique
est nécessaire pour réaliser cet arrachement.
[10] La multiplication des barrages dans
la société-communauté actuelle est une épiphanie de
ce phénomène invisible.
[11] Le
concept d’artialisation mis au point
par Alain Roger exprime bien cette artificialisation. Au sujet de ce concept,
Philippe Dagen écrit: «Au lieu de supposer qu’il y
aurait deux types de beauté, la naturelle et la libre, suggérer qu’il n’existe
de sentiment de la beauté face à un phénomène naturel, quel qu’il soit, qu’en
raison d’une expérience artistique antérieure, même vague, même inconsciente.
Le néologisme artialisation désigne cette
opération». Archéologie du regard ordinaire, in «Le Monde», 18 mai 2001.
Le rejet de l’art de la part des
dadaïstes peut se concevoir comme ayant à sa racine celui de l’artialisation. Un même phénomène fut actualisé, mais dans
une grande ambiguïté, par les surréalistes. Or, A. Breton affirma «l’œil existe
à l’état sauvage» (Le surréalisme et la peinture). Une ambiguïté
s’affirme également dans la revendication du primitivisme à partir du début du xxe siècle.
[12] En revanche, il ne semble pas que la
musique le soit, bien qu’elle implique depuis des siècles un langage formé de discreta et une technique.
[13] A
titre d’exemple indiquons que la représentation freudienne, comme celle de
Descartes, part de l’enfant, du je; celle de Melanie
Klein ou de K. Marx de l’objet (la mère), enfin les représentations hindouistes
peuvent donner une indication en ce qui concerne le troisième cas.
[14] Ce qui est appelé fondamentalisme,
opérant actuellement au sein de diverses religions, en est un bel exemple,
témoignant de l’importance de la spéciose. C’est à cause de ce phénomène qu’A.
Malraux a pu dire que le xxie
siècle serait religieux.
[15] Être
fou c’est être insensé: ne pas avoir de sens.
[16] J’emploie ce terme, valable seulement
en première approximation, pour désigner l’appartenance à un ensemble de
traditions, de modes de vie et d’être, de croyances etc., qui sont encore
opérants dans une aire géographique donnée (ceci étant déterminé par les
événements historiques). Ceci pourrait également s’indiquer par le terme de
particularisme. Cela concerne la culture et non une donnée biologique. Ainsi en
France, on peut, par exemple, considérer une dimension ethnique bretonne,
picarde, auvergnate, corse, provençale etc. Le phénomène d’homogénéisation tend
à éliminer ces diverses dimensions.
[17] Nous
n’aborderons pas leur étude du fait que là il s’agit de façon prévalante de la spéciose et du comment elle s’exprime au
travers, par exemple, du mouvement de la valeur ou de celui du capital.
[18] L’évasion est une forme de
recouvrement que je n’étudierai pas ici. Elle présente de multiples facettes et
témoigne de l’inaccessibilité au réel.
[19] J’ai
déjà rappelé que divers théoriciens avaient affirmé que la vie est souffrance.
D’autres ont affirmé que le réel est inaccessible, par exemple, J. Lacan. Il
n’est pas le seul. On trouve cette affirmation assez répandue chez divers
physiciens. On peut se demander si ce n’est pas à une telle conclusion
qu’aboutit tout le développement de la science. On peut constater aussi que la
première affirmation induit pour ainsi dire la seconde, comme cela apparaît
chez A. Schopenhauer ou Bouddha, à la suite, d’ailleurs, de toute une série de
penseurs hindous, et ce au travers de diverses variantes.
[20] En vertu de son étymologie, trauma
inclut l’idée de passer au-delà.
[21] Le
discours publicitaire exprime bien l’ontose en son stade actuel. Des slogans
comme: «Interdit de vieillir», « Prenez le temps d’aller vite…» signalent l’insaisissabilité
du réel et la présence de l’état hypnoïde en chaque homme, chaque femme. La
publicité est une manifestation du monde mercatel que
les êtres ontosés ont produit pour être en adéquation
avec leur environnement. Le monde virtuel tend à le remplacer.
[22] Cf. thèses 84 et 85.
[23] Ceci
s’est imposé à diverses époques au sein des diverses aires géo-sociales.
C’est particulièrement spectaculaire à l’époque des Royaumes combattants en
Chine (cf. thèse 4 et note 4): cf. Shang Yang, Le Livre du prince
Shang, traduit du chinois et présenté par Jean Levi,
Ed. Flammarion, 1981 et Stratégies du pouvoir ive-iiie siècle avant J.C. Dangers du discours,
traduit du chinois et présenté par Jean Levi, Ed.
Alinéa, Aix-en-Provence, 1985.
[24] Au sujet de ce point fixe (cf.
également thèse 18), les considérations de H. Arendt sur le point d’Archimède
in Vita activa. La condizione
umana (titre original, The
Human condition), Ed. Bompiani,
Milano, 1991, dans le chapitre final «La “Vita
activa” et l’époque moderne», sont particulièrement intéressantes et mettent en
évidence comment la pratique scientifique est une modalité de positionnement
afin de trouver une continuité. En même temps ces considérations témoignent de
l’activité technique, manipulatrice de l’espèce qui tend à escamoter ce qui la
tourmente. «[…] nous manipulons toujours la nature à
partir d’un point de l’univers qui se trouve hors de la terre», p. 194.
Manipuler pour se sécuriser, atteindre une continuité. La nécessité d’opérer à
partir d’un point «hors de la terre» est justifiée par le théorème de K. Gödel.
La
traduction du livre de H. Arendt est parue sous le titre La condition de
l’homme moderne, Calmann-Lèvy, Paris, 1961.
[25] Cf.
à ce sujet C. Lévi-Strauss et Tobie Nathan. La vogue de l’écologie se comprend
du fait qu’elle inclue la notion de topos: le biotope.
[26] Trauma dérive d’un mot grec qui signifie perforation.
[27] La
projection est fondamentalement un phénomène naturel. Les divers organes se
projettent dans les centres nerveux encéphaliques, particulièrement dans le cerveau
qui, lui aussi, se projette dans des centres sous-corticaux,
ce qui permet l’autorégulation, les ajustements nécessaires. Le cerveau, ou
télencéphale, est parfois confondu avec l’encéphale, ou non distingué du
diencéphale comportant des centres essentiels comme le thalamus ou
l’hypothalamus et l’hypophyse qui le prolonge. La terminologie est souvent
imprégnée de confusion. Parler de cerveau reptilien pour Homo sapiens n’a
pas de sens, parce que le télencéphale n’est pas développé chez les reptiles.
D’autre part, l’importance du cervelet est totalement négligée. Or, Homo
sapiens se distingue non seulement par le développement prodigieux de son
cerveau mais également par celui de son cervelet qui peut se concevoir
analogiquement comme un centre de tous les phénomènes inconscients, substrats
de ceux conscients (il y a continuité), régis au niveau du cerveau. La non
reconnaissance de l’essentialité du cervelet peut se connecter à la
dévalorisation de ce qui est inconscient, à la peur de ce qui est inconscient.
[28] Les «mythes» du Don Juan ou du
Casanova l’expriment parfaitement.
[29] Exemple:
«Je voudrais vous voir attachée à un poteau et vous faire souffrir, mais
j’espère bien qu’on vous fera pire que la torture car cela m’est odieux de vous
entendre dire que tout le monde peut être heureux». Lettre anonyme du 01
juillet 1890 à Louise Michel, citée par Françoise Thébaud,
Louise Michel en toutes lettres, in «Le Monde», 07 janvier 2000. Le
contenu de la remontée de l’anonyme c’est: ce que j’ai vécu fut pire que la
torture.
[30] C’est intentionnellement que je réanalyse cet exemple de remontée. On peut le comparer à
celui donné en la note précédente. C’est la possibilité du bonheur pour tous,
désir profond de l’anonyme, affirmée par L. Michel, qui lui provoque la
remontée. Comme il ne peut pas reconnaître son désir, toujours non réalisé, ni
l’immense souffrance pour laquelle il a toujours cherché une cause, L. Michel
devient le support de son ou sa (ou les deux) tortionnaire(s) qui ont toujours
nié activement son désir et qui ont opéré en sa toute prime enfance. La haine
refoulée est transférée sur elle.
[31] «Plutôt
que de liberté, en effet, c’est sans doute davantage de simplicité dans le
rituel des relations amoureuses qu’il faut parler. La sexualité accède
progressivement au statut d’une pratique naturelle, qu’il n’est plus besoin
désormais d’exorciser pour la pouvoir vivre. De ce point de vue, on pourra
analyser la floraison de la pornographie – en particulier au cinéma et,
aujourd’hui déjà, à la télévision – non comme un facteur de libération des
conduites sexuelles mais au contraire comme une entreprise de contrôle social:
de là peut-être la tolérance dont elle bénéficie dans les régimes
conservateurs». André-Clément Decouflé,
Les mœurs demain, in Histoire des mœurs, Ed. Gallimard,
Encyclopédie de la Pléiade, Paris 1991, t. III, p. 170.
[32] La sous-vie
peut se définir comme l’ensemble des phénomènes vitaux où s’impose notre
affirmation immédiate déterminée par l’ontose et dont, souvent, nous avons
honte. La survie est l’ensemble des procédés vitaux qui tend à nous permettre
d’échapper à cela. Le cheminement de libération-émergence
ne comporte pas la recherche d’une voie du milieu, mais l’abandon de la
dynamique qui nous conduit à sousvivre et survivre.
[33] De
récentes conduites visant à faciliter les rapports sociaux, comme le
politiquement correct et le sexuellement correct, expriment en fait une
répression «douce».
[34] Comme il y a eu une anthropomorphose
de la propriété foncière, puis du capital, il y eut – à la fin du féodalisme
durant la genèse du mode de production capitaliste – une anthropomorphose du
travail, au travers de l’essor de l’artisanat. Son évanescence en la société-communauté actuelle se révèle angoissante non
seulement à cause de ses conséquences économiques néfastes pour l’individu,
mais parce que c’est la perte de la possibilité de recouvrir.
[35] Les
guerres et surtout les révolutions apparaissent comme des phénomènes opérant
l’élimination des recouvrements devenus inopérants, qui encombrent, inhibent
désormais un devenir.
[36] Comme cela est patent dans la
thérapie jungienne. Les mythes, les archétypes auxquels le patient est convié à
s’adonner lui permettent de recouvrir ce qui le fait souffrir, le sécuriser
quelque peu, et l’intégrer au monde en place. Cela lui donne un sens de vie!
Une étude de l’œuvre et de la vie de C.G. Jung le montrerait à suffisance. Je
rappelle que, selon moi, C.G. Jung est l’homme du recouvrement.
[37] C’est
un peu ce que G.W.F. Hegel décrivait quand il exposait le travail de l’Esprit.
[38] Au cours du sommeil, durant les
phases oniriques, tend à s’opérer une mise en continuité des différents niveaux
d’expression de l’individu: organique, émotionnel, affectif (sentiments),
intellectuel. L’incohérence des rêves «traduit» celle, difficilement
éliminable, de l’individu ontosé. Le passage d’un
niveau à l’autre peut se concevoir selon un phénomène de transduction.
[39] Qu’on
retrouve dans la philosophie hégélienne.
[40] Dans les nº
2 et 3 d’«Invariance», série v,
j’ai illustré cela dans le cas de S. Freud et, dans le n° 4, en ce qui concerne
A. Adler. Une étude de l’œuvre et de la vie de Melanie
Klein est en projet afin d’illustrer les phénomènes du pôle féminin.
[41] L’enfant-roi
(intronisé par la consommation) est un rejouement de
l’enfant déifié (enfant-dieu), de l’enfant-réceptacle en qui la mère place toutes ses
espérances.
[42] Depuis
quelques années la situation évolue, et on assiste à un mouvement des hommes
tendant à accéder à une paternité plus intégrale. Mais il s’accomplit encore
trop souvent médiatisée par la lutte contre les femmes, alors qu’il s’agit de
devenir conscient d’une dynamique aberrante, concernant les deux sexes, qu’il
faut abandonner.
Dans
diverses aires géo-sociales et à diverses époques,
l’homme ne devient un père effectif qu’à des âges parfois assez avancés de
l’enfant, souvent après qu’il ait subi une initiation qui fut et est toujours
traumatisante.
[43] Cette
affirmation ne vise nullement à poser une théorie dualiste, voire trinitaire,
puisque l’enfant réalise l’effectivité de l’union de l’homme et de la femme.
Elle vise à rejeter toute théorisation individualiste. On ne peut pas
appréhender la réalité à partir d’un élément déterminé comme basal, à partir
duquel on pourrait reconstituer le tout. La réalité ne peut s’appréhender qu’en
fonction de la totalité, de la multiplicité et de l’unité, perçues
simultanément.
[44] En
la phase actuelle, finale du développement de l’ontose-spéciose,
l’avortement hante hommes et femmes, qu’ils soient pour ou contre. Tous disent
quelque chose de la souffrance qu’ils éprouvent d’avoir été avortés.
[45] Le
suicide en tant que refus ultime s’est également imposé, comme celui de cet étatsunien qui s’immola par le feu en 1965 pour protester
contre la guerre au Vietnam. Il reprenait une pratique-technique
qui, à la même époque, était utilisée par les bonzes.
L’euthanasie
et la pratique d’accompagner les mourants relèvent d’une technique qui
permettrait à l’homme, la femme, de bien mourir, d’apprendre à mourir, à bien
effectuer un dernier recouvrement.
[46] Homo
sapiens doit éviter l’excès et la dépression,
le capital l’inflation et la déflation, tant qu’il ne s’est pas pleinement
autonomisé.
[47] En
ce qui concerne la nature, à la place de se réconcilier, je préfère dire: se
remettre en continuité avec elle.